Présent au Conseil Départemental des Bouches du Rhône à la cérémonie en l’honneur des athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, Fabien Lamirault, double médaillé d’or en para tennis de table, s’est confié sur son aventure nippone et la construction de sa carrière. Il pose un regard lucide sur l’accompagnement des sportifs de haut niveau et se prépare déjà à vivre de grands Jeux à Paris en 2024.
Comment allez-vous depuis votre doublé?
Ça va bien, j’ai l’impression d’être toujours dans le retour parce que depuis un mois, ça enchaîne entre les sollicitations, les réceptions, les obligations avec les partenaires, etc. En novembre, on devrait commencer à y voir un peu plus clair et repartir pour la suite. Je reprends les stages France sectoriels fin novembre.
Vous avez réitéré la même performance qu’en 2016, comment l’expliquez-vous ?
En 2016, j’étais attendu, j’avais remporté les Championnats du Monde et d’Europe en 2014 et 2015, j’arrivais donc avec le dossard de favori. Ça s’est bien passé. C’était l’aboutissement d’aller chercher la plus grosse performance d’une carrière. A Tokyo c’était autre chose; il y avait une année en rab avec le Covid derrière. Je voulais garder absolument ce titre pour être le premier dans ma catégorie à le faire, personne ne l’avait jamais conservé et c’était une marche que je voulais gravir. Je suis content de l’avoir fait, mais c’est surtout du soulagement. Autant à Rio, j’étais surexcité comme un gamin, autant là le sentiment qui a prédominé pendant quelques jours c’était le soulagement.
Pourquoi ?
Ce que je voulais faire, tout le monde m’en parlait depuis quinze piges, c’était le doublé. Moi le premier, j’y étais allé que pour ça. Il y avait plus de pression, mais ce n’est pas que la pression, c’était plus compliqué dans tout, avec le Covid, la préparation reportée et tronquée, l’absence de compétitions. J’aime bien aller en compétition avec un peu de références, bien que je sois numéro un. J’aime bien aussi cette part de doute, et elle était plus importante qu’à l’accoutumé. La part de doute, c’est ce qui maintient un petit peu la flamme, c’est pour ça que j’aime bien la garder. Cette victoire n’a pas été un long fleuve tranquille, ça a été plutôt difficile et acharné. Surtout en demi et en finale où il a fallu aller chercher des ressources ailleurs qu’à la table.
L’absence de public et le report d’un an des Jeux Paralympiques n’ont pas été un problème finalement.
Le report d’un an ne m’a pas chamboulé, je suis reparti sur le même programme mais les deux compétitions prévues en mai 2020 et reportées en 2021 n’ont pas eu lieu. L’absence du public, de ma famille et des supporters m’a beaucoup plus impacté. C’est ce qui fait aussi que ça a été dur jusqu’au bout. T’as besoin tous les jours d’avoir des contacts rapprochés et de sortir de la bulle ping. Je savais que ça serait un manque et on a fait sans, c’est ce qui a été compliqué à gérer. Je n’étais pas dans ma zone de confort. Ça a quand même bien fini parce que si vous demandez ma qualité première à mes amis, ils vous diront que c’est le mental. Je n’ai jamais fait de préparation mentale. J’ai vu deux préparateurs mentaux, et les deux m’ont dit que c’était pas la peine qu’on bosse ensemble (rires). À ce niveau, je réponds présent. Je tiens quand même à signaler que j’avais du public, j’avais une quinzaine de Français qui criaient derrière moi. Ça fait chaud au cœur, toutes les délégations n’ont pas eu cette chance.

« On a beau dire ce qu’on veut, mais l’argent, souvent, c’est le nerf de la guerre »
Vous êtes le seul athlète à avoir ramené deux médailles d’or des Jeux Paralympiques et votre sport a été le deuxième pourvoyeur en médailles. Le para tennis de table est-il le para sport le mieux développé en France ?
Non, je ne crois pas. On a vraiment du mal à attirer, à avoir des jeunes. Nous sommes les héritiers d’une ancienne génération qui a bien marché, aujourd’hui on est en place mais on a du mal à faire venir des joueurs pour les amener au haut niveau.
En termes de résultats sportifs, il n’y a eu que deux meilleurs bilans de médailles au XXIème siècle mais c’est toujours décevant en termes de classement. Comment l’expliquez-vous ?
L’objectif pour Paris, c’est qu’on soit dans le top dix olympique et paralympique. On a fait cinquante-quatre médailles, mais on n’en a « que » onze en or. On a énormément de bronze. Le travail que l’Agence Nationale du Sport doit faire, c’est de potentialiser toutes ces personnes pour changer la couleur de la médaille. Ça s’explique aussi parce que les autres équipes bossent. Des nations qui ne sont pas forcément des grands noms ont beaucoup d’or, comme l’Azerbaïdjan (quatorze médailles d’or sur dix-neuf médailles au total, ndlr). Ça montre qu’ils ont segmenté leur groupe et exploité son potentiel au maximum. Ils ont pris quelques personnes avec de grosses capacités et ils ont tout misé sur elles. Au ping, beaucoup de nations comme l’Ukraine ont des fonctionnements différents du nôtre. Aux Jeux Paralympiques, ils ont des moyens de dingues et ils se mettent à fond dessus.
Certainement parce qu’il y a un investissement massif derrière…
Oui, l’investissement est massif depuis des années. On a beau dire ce qu’on veut, mais l’argent, souvent, c’est le nerf de la guerre. Mon entraîneur a un poste à temps plein, il est cadre de santé au ministère des Armées à l’hôpital Percy en région parisienne. Si on ne parvient pas à ce qu’i soit plus disponible pour m’entraîner, on n’avance pas trop. Il faudrait pas que les entraînements ne soient plus pris sur un temps de vacances mais sur le temps de travail. Il y a des choses à faire. Le train est en marche, l’idée est de faire un peu plus, avec des touches supplémentaires sur les athlètes et les staffs. La finalité, ce sont les médailles d’or et le classement des médailles. Ce n’est pas faire la révolution, mais plutôt des touches personnelles pour accompagner au plus près chaque individu.
Avez-vous ressenti beaucoup d’engouement de la part des Françaises et Français durant ces Jeux et selon vous, la médiatisation est-elle en progression et sommes-nous sur la bonne voie en vue des Jeux de 2024 ?
Avec France TV, on savait qu’ils allaient faire le même dispositif qu’à Rio avec cent heures en direct. On savait aussi qu’avec le décalage horaire, ça serait plus compliqué. France TV dépendait aussi des images mises à disposition par l’organisation , et je sais que dans des disciplines comme l’escrime, il y a eu zéro image. Nous avons de grosses certitudes pour Paris 2024. Ça s’annonce très bien, il y a une volonté forte de l’organisation des Jeux, et il n’y aura pas de décalage horaire cette fois-ci (rires).
Vous dites vouloir marquer l’histoire de votre discipline, n’est-ce pas déjà fait avec déjà douze titres glanés lors de grandes compétitions ?
Ça n’est pas suffisant. Dans mon esprit je ne suis pas encore le numéro un français avec tout ça. Il me manque au moins un titre mondial pour égaler la meilleure performeuse de l’histoire de ma discipline. Si ça se passe bien d’ici Paris, il y a de fortes chances que j’atteigne mon objectif.
Votre premier podium remonte à 2011 avec une médaille d’argent par équipe au Championnat d’Europe à Split (Croatie). Depuis, vous êtes médaillés à chacune des compétitions dans lesquelles vous êtes engagé. Comment garder le même niveau d’exigence et de motivation aussi longtemps ?
Il y a la faim de remplir le palmarès et d’avoir toujours envie de gagner. Il y a plein d’opens que je perds car je ne suis pas à ce niveau-là dans la tête. Sur les grands événements, la tête est là, et le niveau aussi. Forcément, on arrive à accéder au podium naturellement. J’y vais pour gagner, parce qu’accéder à des titres, c’est ça qui me plaît.
Cette fois-ci, vous n’avez que trois ans pour vous préparer.
C’est court. L’année de transition est grillée. Mentalement, ça sera dur ou non, de se dire qu’on a une échéance proche qui va arriver, ça sera peut-être plus facile de reprendre la raquette dans le garage. On nous parlait souvent des cinq années avant Tokyo, mais peut-être que les trois ans derrière seront plus compliqués à gérer. Il y a un championnat du monde l’année prochaine donc on sera dans la continuité. Ce que je crains, c’est de m’essouffler avant 2024, il faut rester sur la dynamique pour ne pas avoir de flottement. Avant de reprendre, il faut savoir libérer sa tête et son esprit. C’est important d’avoir une coupure et d’avoir un niveau de relâchement. Le monde du sport nous bouffe les tripes au quotidien avec la pression et tout ce qu’on y met autour. Il faut avoir des soupapes, on en a besoin. Moi je l’ai à Nans-les-Pins (Var) chez moi avec ma famille. Quand on arrive à trouver cet équilibre, on est plus fort.

« Il y a des années où je dépensais de l’argent pour être dans les meilleures mondiaux »
La construction et les débuts de votre carrière de sportif ont-ils été compliqués en termes d’accompagnement et de soutiens financiers ?
Oui ça a été compliqué. Je n’avais pas prévu de faire ça dans ma vie. Quand j’ai mis les pieds dans un club sportif suite à des essais dans un centre de rééducation, c’était pour le plaisir de faire du sport. J’ai eu la chance d’arriver au Cercle Sportif à Paris, un club omnisport de l’armée ouvert aux civils, et archi structuré. Il y avait déjà des athlètes et des encadrants de sportifs olympiques pour l’escrime et l’athlétisme. Ils m’ont fait rêver pour la suite.
C’est difficile de s’imaginer qu’on peut en faire sa carrière ?
Ça dépend des rencontres et des discussions. C’est parfois des échanges informels qui font naître des envies, l’envie d’aller vivre des aventures. Quand les mecs te racontent les Jeux de Sydney qui étaient apparemment énormes, t’as envie de te dire “pourquoi pas moi ? “. J’ai eu de la chance d’avoir un club qui m’a accompagné. Ils m’ont payé les tournois, etc. Si t’as pas une structure sportive pour aider les jeunes, financièrement c’est lourd. Et quand on est jeune et inconnu, pour avoir des partenaires, pour faire ça, c’est impossible, donc ça veut dire que c’est sa poche ou celle des parents. C’est énormément d’investissements quand on débute. Et même par la suite, ce n’est pas simple non plus. Pour pas mal de collègues, avoir des aides extérieures, ça reste compliqué et ça concerne le monde olympique et paralympique. Mon club m’a beaucoup aidé jusqu’en 2011 avant que j’intègre l’équipe de France. Mais je n’avais pas de contrat ni d’aide extérieure au delà. Il y a des années où je dépensais de l’argent pour être dans les meilleurs mondiaux. Il faut savoir ça. Ce n’est pas tout frais payé, et je ne parle même pas de gagner de l’argent. Jusqu’à Londres en 2012, j’ai toujours été déficitaire. Ça parait fou mais ça m’a coûté de me qualifier pour Londres. J’espère qu’avec toutes les aides aujourd’hui ce n’est plus le cas pour ceux qui sont dans le circuit, mais pour un jeune qui veut y aller, au début, il faut cravacher et investir.
Maintenant tout va bien, j’ai eu de la chance car en 2013 j’ai signé un contrat avec la police nationale. Ça a duré cinq ans. J’étais employé par le ministère de l’Intérieur, avec un salaire mensuel mais détaché à 100% pour ma discipline en échange d’actions de promotion pour la police. D’un seul coup tu vois le truc complètement différemment. J’avais fait des demandes d’aide après les Jeux de Londres, mais j’ai fait chou blanc… Ça n’intéressait personne. Ce n’est pas motivant. La police m’a permis de gagner ma vie, j’étais payé pour faire mon sport. Ça m’a fait un bien fou, et c’est comme ça que sportivement ça a marché. En 2018, ça s’est arrêté, et jusqu’en 2020, je n’avais pas de sponsor individuel. J’avais des aides de la région, du département, et la force du club qu’on a créé à Marseille début octobre 2016 avec cinq collègues, le Marseille Provence Tennis de Table Handisport (MPTTH). Le but est de créer une structure pour accompagner et prendre en charge un gamin qui veut se lancer dans ce sport. Aujourd’hui, mes saisons sont financées.
Désormais, vous êtes engagés dans plusieurs partenariats. Concrètement, comment un sponsor vous aide-t-il à pratiquer votre sport ?
En 2020, les sponsors sont venus à moi. Je pense à Engie, à Nestlé; via la Fédération, j’ai un partenariat avec la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, je suis rentré au bout de deux ans à l’armée des champions. Les partenaires apportent une sécurité financière. Je suis passé du stade où ça me coûte zéro, au stade où je gagne ma vie. C’est une fierté de dire que c’est vraiment mon métier. Ce sont des contrats de sponsoring ou de mécénats de grosses boîtes qui aident les athlètes via le pacte de performance.
« Globalement, il y a quand même du progrès dans l’accompagnement »
Avoir des partenaires, ça change donc une carrière?
Oui, c’est pour ça qu’il est dommage de ne pas identifier des jeunes à potentiel très tôt pour les aider à se structurer. Mais il faut dire quand même que beaucoup de choses ont été faites, on ne se réveille pas maintenant. On l’a ressenti, heureusement qu’il y a Paris, mais j’espère que ça continuera après. Il faut mettre le sport français en haut de la liste et arriver régulièrement dans le top dix.
Votre première compétition c’était en Sicile (Italie) en 2003. Comment a évolué l’accompagnement des sportifs comme vous au fil du temps ? Avez-vous le sentiment que la considération est plus importante qu’à l’époque ?
Oui, l’accompagnement est différent. Et Paris 2024 y fait beaucoup. Avant, on avait quatre stages dans l’année, aujourd’hui on en a quasiment un tous les mois, donc on voit bien la différence. Au-delà de ça, on a plus de soutien de la fédération, des institutionnels, on arrive à mieux se structurer, et ça c’est vrai pour ceux qui sont déjà dans la boucle. Pour ceux qui sont dans l’antichambre, ça reste compliqué. Mais globalement, il y a quand même du progrès dans l’accompagnement. Ça suit aussi la chronologie du monde du handicap dans la société depuis vingt ans. Le regard change et ça aide.
Est-ce difficile, en France et en 2021, d’être un athlète non valide ?
Non, non. C’est pas difficile, on est plutôt aidé. Me concernant, le côté handicapé passe après le côté sportif. Mon collègue avec qui j’ai gagné les deux médailles d’or (Stéphane Molliens) arrête, et son nouveau rôle dans les trois prochaines années va être d’encadrer pour essayer de structurer le réservoir et inculquer le haut niveau. Dans cette acculturation, on met le sport et le haut niveau en un, et le handicap loin derrière. C’est un état d’esprit du quotidien. Aujourd’hui, pas mal de choses sont faites pour qu’on puisse performer, on est accompagnés. C’est beaucoup plus facile qu’il y a vingt ans en arrière.
Célestin Barraud








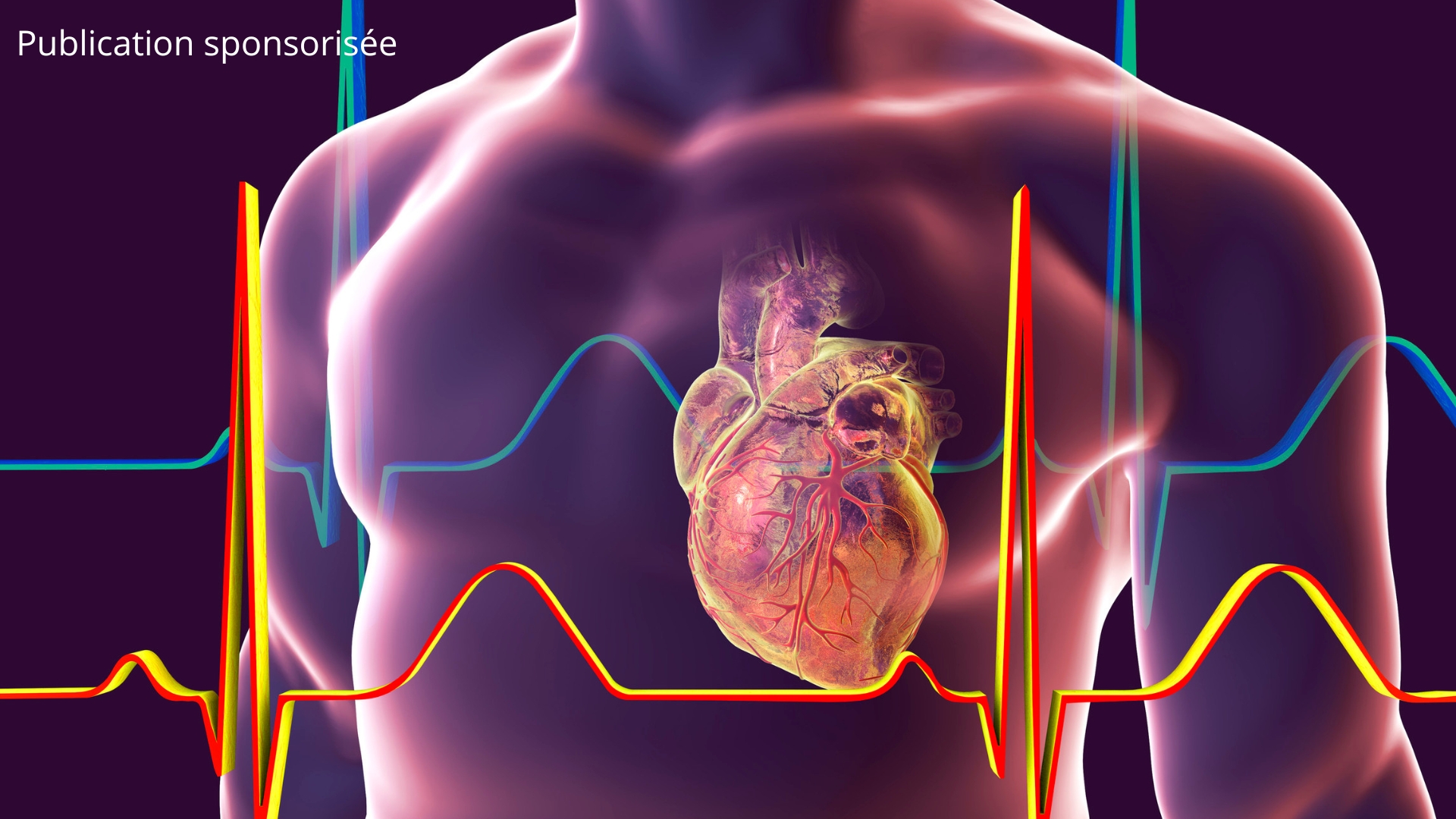











cet article vous a plu ?
Donnez nous votre avis
Average rating / 5. Vote count:
No votes so far! Be the first to rate this post.